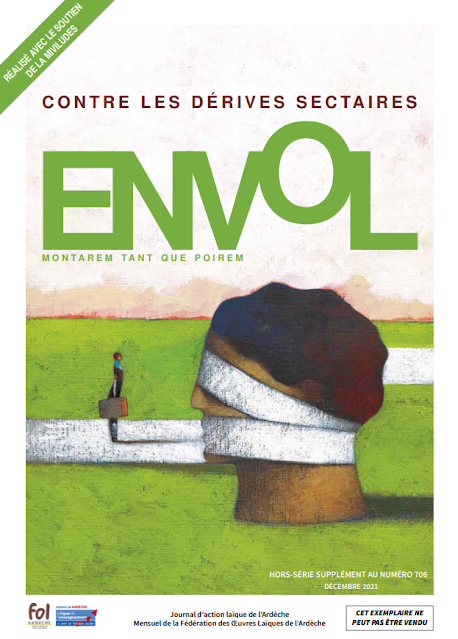Nous avons évoqué récemment la procédure
initiée par des institutions relevant de la mouvance de Rudolf
Steiner à l'encontre de Grégoire Perra. Nous avons tenté
d'éclairer les considérants à la lumière du droit. Or le hasard
peut bien faire les choses, le Conseil de l'Europe, l'institution à
laquelle est rattachée la Cour européenne des droits de l'homme, et
qui, cela va mieux en le disant, ne doit pas être confondu avec
l'Union
européenne, vient de publier un ouvrage sur le droit de la presse et
la diffamation.
Puisque nous étions au cœur de cette
problématique, que nos lecteurs nous permettent, même si
nous nous écartons un
peu de notre objet social, d'examiner les nuances entre le droit européen
des droits de l'homme, qu'irrigue la jurisprudence de la Cour
européenne, et le droit national, qui a permis au juge de relaxer
Grégoire Perra. Nous avions conclu de diverses décisions
judiciaires qu'il fallait distinguer la calomnie de la diffamation.
Cette dernière n'était que l'atteinte à la réputation d'autrui,
dont l'auteur pouvait contester le caractère délictueux en prouvant
sa bonne foi.
Pour la Cour européenne, il y a
diffamation dès lors que la personne mise en cause voit sa
réputation ternie pour des raisons qui s'avèrent fausses. Dans le
texte :
Au cœur de la diffamation se trouve
donc l’atteinte à la réputation. Au sens précité, une
« déclaration » peut, dès lors qu’elle est véridique,
être percutante ou durement critique, sans pour autant relever de la
diffamation, car une personne ne peut prétendre qu’à une
réputation fondée sur la vérité. Elle ne sera diffamatoire que
s’il s’agit d’une déclaration factuelle fausse ou erronée
concernant une autre personne, car seules de telles allégations
nuiront à la réputation dont une personne mérite de bénéficier
auprès de ses pairs ou au sein de la société. Dans certains cas
limités, un commentaire que les faits ne permettent pas d’appuyer
ou qui se révèle excessif compte tenu des faits peut également
relever de la diffamation.
La Cour européenne accorde grande
importance à la distinction entre les faits rapportés et les
jugements de valeur. Autant la calomnie basée sur des faits allégués
qui s'avèrent erronés est considérée comme diffamatoire, autant
les jugements de valeur relèvent du débat politique ou du débat de
société qui ne souffre qu'exceptionnellement d'atteinte à la
liberté d'expression. Dans le texte : La
Cour a estimé que « le libre jeu du débat politique se trouve
au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la
Convention tout entière » (...). Le discours politique se voit
par conséquent offrir une « protection privilégiée »
au titre de la Convention. Dans ce sens, « l’article 10,
paragraphe 2, de la Convention ne laisse guère de place pour
des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du
discours politique ou des questions d’intérêt général ».
C’est en droite ligne le sens
d’une des argumentations développées par le TGI de Strasbourg qui
a relaxé Grégoire Perra
TGI STRASBOURG jugement du 7 octobre 2021
Et c'est ce qui explique nous semble-t-il
que nos amis de l'UNADFI, qui avaient été la partie gagnante lors
d'un litige qui les avait opposés à un avocat proche des témoins
de Jéhovah, se sont retrouvés la partie perdante pour les mêmes
raisons lorsque ce même avocat se pourvut devant la Cour européenne.
(Arrêt Paturel contre France du 22 décembre 2005):
La Cour rappelle à ce titre que les
associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles
descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles
sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un
plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées
par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en
œuvre dans le débat (...). Or, en l'espèce, l'UNADFI est une
association œuvrant dans un domaine qui intéresse le public, à
savoir les pratiques des organisations de type sectaire. Elle prend
part aux débats publics, son objet étant précisément
l'information du public sur le phénomène sectaire, ainsi que la
prévention et l'aide aux victimes. Nul ne conteste qu'elle exerce
ses activités statutaires de manière active
Même si parfois nous pouvons ne pas nous sentir satisfaits par la jurisprudence de la Cour européenne, n'oublions
pas que le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de
l'homme sont des institutions nées de la volonté de ne pas revivre
les totalitarismes qui ont ensanglanté l'Europe et le monde entier
au milieu du XXe siècle. La Cour européenne des droits de l'homme
fut présidée par René Cassin, juriste de la France libre. Pour
nous situer toujours dans l'objectif de la défense des droits de
l'homme n'allons surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain et
défendons une institution plus que nécessaire en ces temps où le
populisme risque de gangréner notre continent.